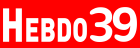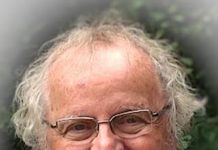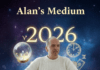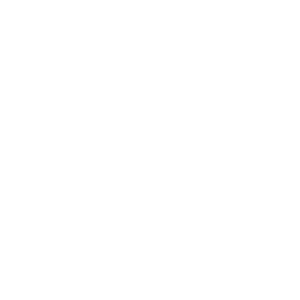Plusieurs semaines après votre arrivée, quel est votre constat à propos de la santé en Bourgogne-Franche-Comté ?
Nous avons une région plus vieillissante que la moyenne nationale, avec un indice de vieillissement à 99,5 (nombre de personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans : plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes ; plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées, ndlr) contre 83,1 en France métropolitaine. La population âgée de 60 ans et plus est de 30%. Les besoins en santé sont donc importants, notamment autour de la prise en charge de la dépendance. Cela a également un impact sur les professionnels de santé chez qui la dynamique démographique est similaire, ce qui nous oblige à anticiper l’offre de soins. Nous avons aussi des indicateurs un peu plus défavorables qu’au niveau national, notamment sur les maladies cardio-neurovasculaires. La santé mentale est également concernée. Notre région est la cinquième plus vaste de France, avec une ruralité très marquée. Les distances pour se soigner sont donc un enjeu important dans un territoire très disparate. Le Doubs est le seul département à gagner des habitants et, à l’intérieur même de ce département, la bande frontalière, Besançon et le Doubs « central » présentent déjà des situations très différentes.
Il est “plus simple” de se soigner dans le Doubs qu’ailleurs ?
C’est une population qui vieillit moins, et l’offre de soins y est globalement moins défavorable que chez ses voisins, malgré les difficultés propres à la bande frontalière et la concurrence avec la Suisse. On ne minimise pas les difficultés du Doubs, mais c’est par exemple le seul département de la région à ne plus comporter de zones rouges — ces secteurs définis par une densité très faible de médecins généralistes rapportée à la population.
À Pontarlier, le CHIHC a subi une cyberattaque dans la nuit du 18 au 19 octobre. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Les équipes font un travail remarquable pour continuer malgré la mise à l’arrêt du système informatique, par mesure de sécurité. Le numéro vert (0 805 090 125) fonctionne bien et permet de confirmer tous les rendez-vous. Il faut que la population sache qu’elle peut — et doit — honorer ses rendez-vous : il suffit d’appeler.
Quel est l’avenir de la direction du CHIHC à Pontarlier ?
Le projet de direction commune entre le CHIHC et le CHU Minjoz à Besançon a été adopté par le conseil de surveillance il y a quelques semaines, pour une durée de deux ans. Il faut maintenant que toutes les instances se prononcent, avant que l’ARS prenne sa décision.
Cela ne signifie pas que la direction pontissalienne disparaît : il y aura toujours un directeur de site et les mêmes compétences à Pontarlier.
Et concernant l’avenir du CHU Minjoz de Besançon ?
Il y a deux CHU en Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon et à Dijon. Il n’est pas question de modifier cela : ils jouent chacun un rôle central pour leur territoire.
Est-ce plus “motivant” de pouvoir piloter des projets dans “sa” région ?
La presse franc-comtoise a l’air heureuse, mais je suis directrice de la Bourgogne et de la Franche-Comté (rires) ! Même si les ARS sont souvent décriées — de manière injuste selon moi, car il y a des agents formidables qui se démènent — le poste est passionnant, et encore plus dans sa région d’origine, oui. Je suis d’ailleurs allée à Pontarlier à l’occasion de la cyberattaque : c’est l’établissement où je suis née !
Vous parlez de “déclinaisons des orientations nationales” à instaurer dans notre région. C’est-à-dire ?
Le pacte de lutte contre les déserts médicaux en fait partie. Le dispositif Médecins solidaires ou Un médecin près de chez vous identifie 14 “zones rouges” dans la région. Derrière, il y a un appel à volontariat pour que des généralistes passent une ou plusieurs journées dans ces secteurs, en échange d’une valorisation financière. Il existe aussi des aides à l’installation, en lien avec l’assurance maladie, avec là encore une priorité donnée aux zones les plus en tension. Des antennes universitaires de première année de médecine peuvent être délocalisées dans des territoires dépourvus de faculté. Nous travaillons également sur une 4ᵉ année d’internat pour les futurs médecins généralistes, qui débutera en novembre 2026. Parmi ces “docteurs juniors”, ceux qui exerceront dans des zones d’intervention prioritaires bénéficieront aussi d’une valorisation financière notable. C’est un renforcement concret de l’offre, et un bon exemple d’orientation nationale déclinée localement. La santé mentale est aussi une priorité, avec des projets territoriaux réunissant tous les acteurs locaux pour établir une feuille de route commune. Nous accompagnons également les établissements de santé afin de favoriser une gradation des soins sur l’ensemble du territoire.
Cette “gradation des soins”, c’est ce que l’on observe déjà à certains endroits dans le Doubs ?
C’est en effet la tendance du système de santé : trouver un équilibre entre une offre de proximité et des compétences plus techniques ou complexes, grâce à un parcours de soins clairement défini. Le Doubs est particulièrement dynamique dans la création ou la rénovation de maisons de santé, par exemple. Les professionnels préfèrent exercer en équipe, et nous soutenons cette évolution. D’autres dispositifs fonctionnent bien, comme la Maison de garde de Pontarlier.
Cette ambition est-elle réalisable malgré les tensions politiques et surtout l’absence de budget ?
Nous faisons notre possible pour garantir la stabilité. Si le budget n’est pas adopté ou pas dans les temps — comme ce fut le cas l’an passé —, il est reconduit “par douzième”. Les hôpitaux ne s’arrêtent pas de tourner, nos programmes restent engagés. La principale conséquence de cette absence de budget concerne nos dépenses et nos engagements : nous devons être plus prudents, mais la continuité du service est assurée.
M.S
Un parcours professionnel fulgurant
De 2012 à 2015, Mathilde Marmier est conseillère aux questions de société, de droits des usagers, de la santé mentale et des populations vulnérables au sein du cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine.
2015 – 2019 : elle devient responsable de la stratégie maladies infectieuses, puis cheffe du service de prévention et des actions sanitaires au conseil départemental de Seine-Saint-Denis
2019 : nommée responsable adjointe du département produits de santé, à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
2020 – 2024 : nommée médecin cheffe du service de la protection maternelle et infantile (PMI), puis sous-directrice santé des enfants, parentalité, santé sexuelle, au sein de la direction de la santé publique de la Ville de Paris.
En 2024, elle devient conseillère santé publique et handicap au cabinet du premier ministre, Gabriel Attal.
De 2024 à juillet 2025, elle est directrice de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines à l’agence de Biomédecine avant devenir directrice de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.