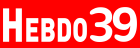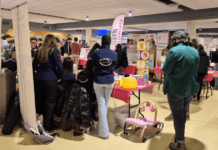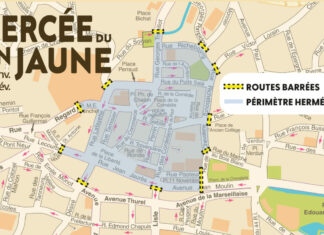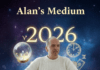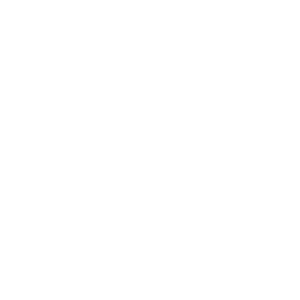Il n’y a pas que les appels téléphoniques intempestifs pour nous pourrir la vie. On nous pollue aussi de fausses nouvelles, de désinformation, d’infox. Si je vivais à notre époque j‘écrirais de fake-news…
Écrasé sous l’avalanche il nous arrive de nous dire : mais pourquoi tant de nigauds nous prennent-ils pour l’un des leurs (1). Quelle est leur motivation pour nous duper en toute occasion ? Les chercheurs en psychologie sociale, en sociologie et en communication avancent quelques explications.
Révéler aux pauvres niais (2) que nous sommes, une information exclusive et choquante qui naturellement avait échappé à nos esprits inconsistants et souffreteux, donne le sentiment d’être plus malin et d’avoir ce pouvoir de révéler sa vérité au monde pour pas un rond (3). Et si pour le même prix on provoque la peur, l’indignation ou la colère c’est un orgasme mental cousin de la béatitude.
Manipuler l’opinion et créer la polémique provoque plus de plaisir chez certains que la pêche à la mouche ou la découverte d’une tache de trompettes.
La Bible nous dit qu’à semer le vent on s’expose à récolter la tempête. C’est dans le Livre d’Osée et effectivement il fallait. Mais récolter la tempête c’est trop bête ! Et manquerait plus… Déjà qu’on crève de chaud avec nos canicules. Mais il existe un moindre mal : pourquoi ne pas plutôt semer le doute. C’est le moyen de
décrédibiliser nos institutions, la science, l’économie. Mais pas nos croyances. Non ! Pas nos croyances.
S’ajoutent dans la gestion des fausses nouvelles des biais cognitifs… (4). Il parait qu’à force de relayer une fausse nouvelle elle devient vraie. Monsieur Émile Coué, pharmacien de son état, le savait il y a cent ans déjà (5). Comme le temps passe !
J’en profite pour faire remarquer qu’à force de dire « comme le temps passe » il finit effectivement par passer. Si ça n’est pas une preuve ça !
Notes pouvant être utiles pour la lisibilité de ce texte
(1)- Qu’il est désarmant ce mot de nigaud. Il nous vient de Nicodème un personnage biblique important qui posa à Jésus des questions ingénues (Jean, III, 4) car il prenait ses paraboles au premier degré. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? », « Peut-il retourner dans le sein de sa mère et renaître ? ». C’est vrai que la régénération spirituelle est un peu difficile à comprendre mais selon Jésus -et beaucoup sont du même avis- Nicodème n’a pas fait beaucoup d’effort. Et Nicodème (on prononçait à l’époque Nigodème) est resté dans les mémoires comme un nigaud !
C’était un peu injuste, mais il est bien tard pour réviser ce mot de 1564.
(2)- Le niais se retrouve en tout lieu et en tout temps. En Comté, quoique à un moindre degré, le niais existe aussi. Mais avec notre vieille habitude de surutiliser le u, on l’appelle plutôt un niolu.
Le crevougnu est souffreteux. Le caribossu est cabossé. Le rônnu est un râleur. Le fierraillu est prétentieux. Je m’en tiendrai là pour ne pas être traité de bécasu, un beau parleur…
Le niolu (de nidus, le nid en latin) est si tôt tombé du nid qu’il n’a pas eu le temps de connaitre les contingences et aléas de la vie. Il est resté un peu niais. On le serait à moins.
(3)- La pauvreté ne date pas de ce siècle. Déjà en 1461, quand le rond était par métaphore une pièce de monnaie on le trouvait rare. Bien sûr, l’argot s’en est mêlé. Il y eu les écus, puis les pièces de cinq centimes, puis le sou. Puis l’on finit par n’avoir plus un rond. C’est là qu’on en est aujourd’hui en attendant de payer la dette.
(4)- Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur qui s’est infiltré par effraction et s’est imposé à nous mais qui altère le jugement et parfois fragilise nos décisions.
Un exemple de biais cognitif est ce biais qui consiste à croire que les bébés choisissent de naitre plutôt à la pleine lune ou à la nouvelle lune qu’en des jours plus ordinaires. Ce biais -à vrai dire sans conséquence- est très répandu.
En 2021, trois chercheurs ont publié une étude sur 38,7 millions de naissances en France pendant 50 ans qui montre un excès de naissance à la pleine lune de 0,4 %. À chacun de voir si la différence lui parait significative.
(5)- Émile Coué, jeune apothicaire avait pris l’habitude dans son officine d’assortir la délivrance des médicaments de compliments élogieux sur les effets décisifs de ces prescriptions. Et les patients guérissaient par poignées le couvrant d’éloge. Il avait découvert l’effet placebo, encore très utilisé de nos jours au point de déborder jusque dans le discours politique.