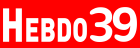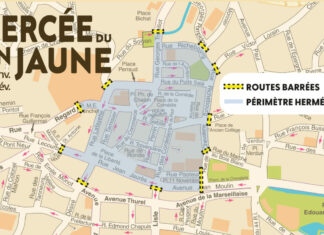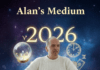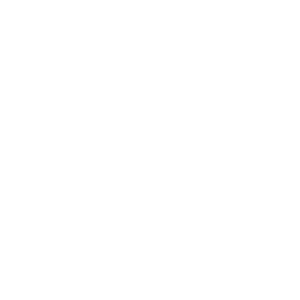Quelle est la situation du Jura avec le sanglier, premier gibier en France ?
Il commet des dégâts et on ne peut que se féliciter de l’accompagnement voulu par l’Etat depuis quelques années. Des aides financières ont permis de solutionner les crises financières majeures subies à ce sujet par certaines fédérations départementales. Nous ne sommes pas dans ce cas, cela a été dit : l’action des chasseurs jurassiens nous a permis de faire face et d’éviter des gros problèmes avec la profession agricole comme il en existe malheureusement ailleurs.
Je tiens à rappeler ce chiffre qui, à lui seul, résume l’implication des chasseurs : 863 000 sangliers ont été prélevés lors de la saison dernière en France, un peu plus de 5 000 dans le Jura.
La situation s’améliore ?
Si la situation s’améliore, au niveau national depuis deux ans, ce ne sera malheureusement que de courte durée, car nous constatons, depuis le covid, une diminution annuelle des effectifs des chasseurs de l’ordre de 20 000 permis en France, donc une pression financière plus forte sur ceux qui restent avec des contraintes sur le pouvoir d’achat des chasseurs. Il faut avoir à l’esprit que le Jura est dans une situation inverse du reste de nos collègues chasseurs : non seulement nous maîtrisons les dégâts mais nous n’avons perdu que 9 chasseurs par rapport à la saison dernière.
Quelle réalité pour le petit gibier ?
Si le grand semble trop bien se porter, ce n’est plus le cas du petit gibier. Nous déployons aujourd’hui des moyens considérables pour maintenir cette biodiversité majeure au sein des champs et des forêts, et nous devons continuer.
Quid du loup ?
Nous constatons l’impact du loup sur la biodiversité avec la disparition d’espèces comme les ongulés à certains endroits. Le cerf du haut Jura paie un lourd tribut au loup. C’est pourquoi, avec les autres fédérations de chasseurs du massif jurassien, nous voulons que soit mise en place une étude pour bien évaluer l’impact du loup sur la faune. Tout ce que nous observons pour l’instant, c’est une diminution des animaux, une déstructuration des hardes, des changements d’habitudes, et quelques restes de cadavres ici ou là…
Et le cerf ?
Nous avons un problème de fond avec l’ONF en Forêt de Chaux. Nous avons été d’accord pour un plan de réduction de population des cervidés dans cette forêt devant l’investissement financier de l’Etat que nous devions accompagner. Mais après 6 années de fort plan de chasse dans cette forêt, dont 2 de très fort prélèvement, qui s’est traduit par le prélèvement de 1 400 cerfs les 3 dernières saisons, il est temps de prendre en compte des indicateurs.
Quand en 5 ans les observations de comptage plongent de 450 animaux observés en 2022 à moins de 50 aujourd’hui, quand des journées entières de traque ne permettent de lever aucun animal car il y en a près de 300 dans les champs, quand les chercheurs de mues, exercice traditionnel du mois de mars, ont bien été en peine cette année de trouver les précieux bois, quand on se targue d’avoir réalisé un plan de chasse à 96 % en utilisant tous les moyens, non pas de chasser, mais d’éliminer les animaux, trop c’est trop. Pendant les dernières semaines de chasse, les agents de l’ONF ont sillonné les routes forestières avec la carabine dans la voiture, ont tiré les animaux dans des enceintes grillagées, n’ont pas mis les pancartes chasse en cours, n’ont fait appel à aucun conducteur de chien de sang pour rechercher les animaux blessés, et ont prélevé ainsi 11 % du plan de chasse. Il ne manquait plus que le tir à la mitrailleuse depuis un hélicoptère. Alors, quand on demande des fourchettes de plan de chasse mini et maxi en hausse pour la prochaine saison, je dis non. Si la raison ne revient pas, nous irons devant les tribunaux. Il n’y a pas que le plan de chasse comme variable d’ajustement dans un massif où la sylviculture qui y est menée l’a transformé en un désert pour l’alimentation animale.