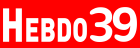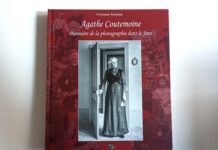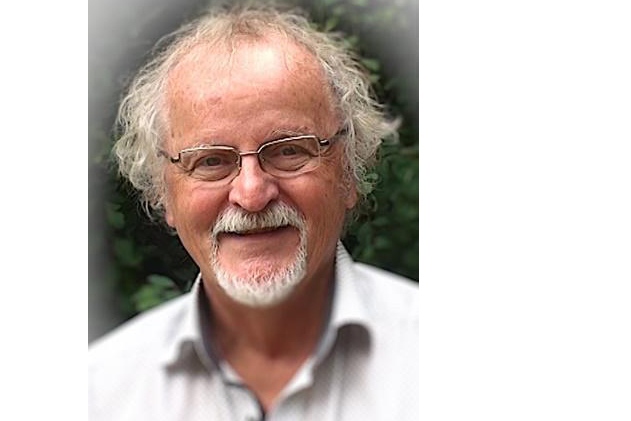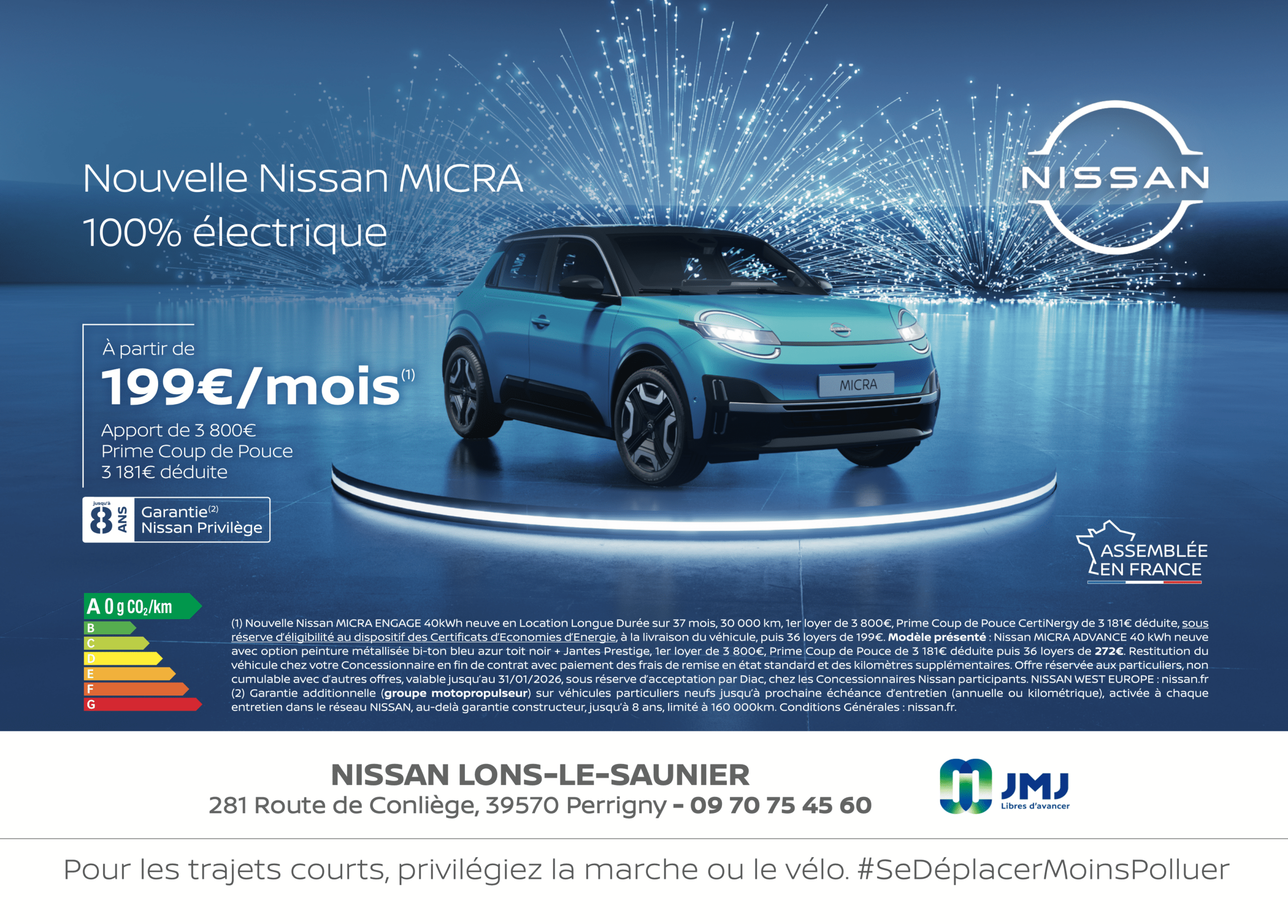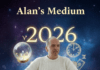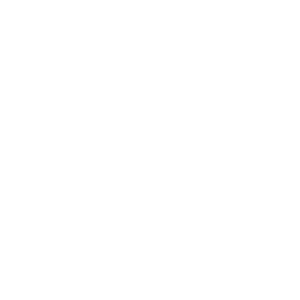Ce matin, la Marie-Madeleine est de mauvais poil (1).
– Vous n’y croyez pas ! Non ! Mais ils ont mangé de lion, ces apôtres ! Et encore l’américain… une bande d’andouilles à lui tout seul ! Voyez comme tout va de guingois (2), ils vont bien finir par nous mettre la planète cul par-dessus tête. Ils se croient tout permis comme s’ils étaient chez eux mais on pourrait quand même des fois nous demander notre avis. Pensez-vous ! C’est comme ça et pis c’est pas autrement… Et quoi dire ?
La Marie-Madeleine supporte à la rigueur qu’on la taquine ou qu’on chipote. Si on l’asticote et qu’on la fait bisquer (3) à la belote au club le mardi, passe encore. Il y a les griottines et le dix de der pour se remettre l’humeur à l’endroit… Mais là c’est trop en faire et elle fulmine. Il est vrai qu’on ne saurait lui donner tort. Et nous-mêmes fulminerions si ce mot n’était pas si mal embouché et imprononçable qu’il pourrait bien vous fiche une rubrique au rebut.
On croirait que la folie des hommes s’est donné rendez-vous et c’est la surenchère.
Comment ne pas se sentir mal fichu quand le monde va de traviole. On peut être désemparé quand tout semble désaxé, bancal, quand tout marche à la va-comme-je-te-pousse et semble foutu.
Les relations entre les gens ne sont plus ce qu’elles étaient.
– De mon temps, ajoute la Marie-Madeleine, à la communale quand les m’as-tu-vu ou les fiers-à-bras (4) nous faisaient la misère on n’y allait pas par quatre chemins : on leur tirait la langue (5) à la récré. Penses-tu ! Elle dit l’Isabelle à la Francine -celle qu’est maitresse d’école à Chaumergy-, aujourd’hui c’est même pas la peine d’y penser ! On aurait les parents d’élèves sur le dos. Comment voulez-vous que les gens s’y retrouvent ? J’ai pas raison ?
Notes pour se faire une idée plus précise :
(1)- Le tempérament soucieux de la Marie-Madeleine la conduit plus que de raison à se faire des cheveux. Et la voilà de mauvais poil !
En latin pilus est le poil. Que les poils se prennent la tête en rangs serrés et la notion capillaire est née.
Le poil a donné lieu à bien des expressions. Ainsi, le neveu de la Germaine « a un poil dans la main ». Mais ça ne l’empêche pas d’enquiller les canons.
Si la Marie-Madeleine est d’humeur maussade la conjoncture géopolitique n’est probablement pas seule en cause. Peut-être -comme disent les roumains-, s’est-elle levée le derrière en haut. D’autant qu’elle dit volontiers qu’avec leurs diableries on ne sait plus de quel côté se tourner pour ne pas avoir froid dans le dos.
(2)- La locution adverbiale de guingois apparait dans les années 1440. Les savants nous disent qu’elle dérive du vieux verbe ginguer, parfois guinguer qui signifiait sauter. On en retrouve la trace dans le parler comtois où ginguer c’était sauter, danser dans le meilleur des cas et parfois donner des coups de pied. Dans La Table aux Crevés en 1929, Marcel AYMÉ nous dit : « C’est pareil que la jument : si tu la voyais ginguer, tu dirais un poulain de six mois ».
On retrouve le sens de danser dans la guingette (qui vient d’ouvrir ses volets comme chaque été), la gigue, le gigolo et… le gigot sans lequel danser serait bien périlleuse entreprise. « Remuer le gigot », en 1650, a le sens que vous deviner mais que je ne saurais écrire ici.
Nos ancêtres étaient probablement de bien mauvais danseurs. Si de guingois trouve son étymologie dans sauter, danser, on est arrivé aujourd’hui à un déplacement tout de traviole. Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre…
(3)- Bisquer c’est enrager, être dépité. Le mot est un rescapé : il est considéré par un linguiste comme « point français » en 1807. Pire ! En 1821 c’est un mot « trivial » et même un « barbarisme ». Il ne sera sauvé de l’oubli où on aurait voulu l’enfouir que par la moquerie enfantine « bisque, bisque, rage ! » qui lui assure de belles années encore. Merci les enfants.
(4)- D’où peut bien nous venir le fier-à-bras ? On est fier comme un coq, comme Artaban ou comme certaines chandelles dans la force de l’âge… On est fier-à-bras depuis très longtemps car vers 1180 Fierabras était le nom d’un géant sarrazin héros d’une chanson de geste. Le vieux verbe férir dans la Chanson de Roland en 1080 signifiait frapper. Il est donc plus question ici de force que de fierté. Nos cousins canadiens sont plus respectueux de cette étymologie. Chez eux un fier-à-bras n’est pas un fanfaron, c’est un homme robuste et volontiers batailleur.
(5)- En Comté, tirer la langue c’est tirer la ligousse et c’est le signe d’une grande difficulté à joindre les deux bouts. D’autres tirent la langue pour signifier l’agacement ou le mépris. Pour son soixante-douzième anniversaire Albert Einstein a superbement tiré la langue à un photographe un peu insistant et cette photographie ne nous quitte plus.