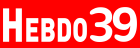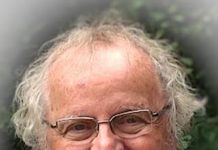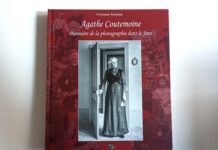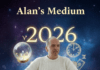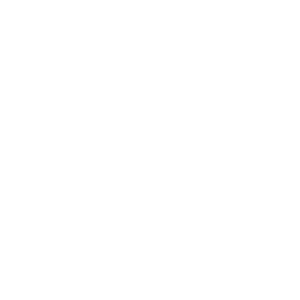Les cons sont partout. Ils osent tout et c’est même à ça qu’on les reconnait nous enseigne Michel Audiard (1). Mais on en connait aussi beaucoup qui n’osent pas.
C’est Georges Brassens qui en donne la définition la plus précise : « Quand on est con, on est con » (2). Le premier d’entre eux qui passe ajoutera : et inversement !
Ce mot d’une crudité choquante, d’une vulgarité affligeante a une longue histoire qui lui a permis aujourd’hui de quitter la culotte où il est né pour entrer dans une dimension littéraire, philosophique et au cœur des sciences humaines.
Le latin cunnus désignait vers l’an 1200 le sexe de la femme dans les écrits satiriques et dans les graffitis. En fait le sexe n’avait aucun rapport… Il devint très vite une insulte destinée aux femmes avant que tout un chacun puisse en bénéficier librement. Ce qui n’était que justice (3).
Le mot, après s’en être donné à cœur joie dans la prose et la poésie, devint lourd à porter au milieu du XVIIème quand s’annonçait le siècle des Lumières. Il faillit tomber dans l’oubli (4). Mais il trouva un regain de vigueur dans la deuxième moitié du XIXème et on le trouve aujourd’hui dans toutes les bouches, lui et ses nombreux dérivés.
De nos jours, on dit qu’il est un con d’une personne stupide qui manque de jugeotte ou d’adaptabilité sociale. Mais on aurait tort de croire que le con n’a que des faiblesses : il est persévérant et il reste fidèle à ses principes.
Pour Albert Einstein qui était loin d’être de la confrérie, deux concepts sont infinis : l’univers et la bêtise humaine. Il ajoutait : pour l’univers je n’ai pas de certitude absolue.
Gustave Flaubert détestait la connerie. Pour lui, le propre du con serait de toujours vouloir conclure avec ses propres opinions toutes faites (5).
C’est pourquoi, par prudence, je ne proposerais pour cette rubrique aucune conclusion.
Je sais trop qu’on est toujours le con d’un moins con que soi.
Notes pour y voir plus clair :
(1)- Nul ne peut prétendre être le spécialiste du con. Ce serait l’être un peu. Mais quand même il faut reconnaitre à Michel Audiard une belle connaissance du sujet. Il disait : « Faut pas parler aux cons, ça les instruit » et aussi « un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche ». Quant aux conneries « c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer. » Pour le Jura et le Doubs, nous devons mettre en ligne notre déclaration avant le 28 mai à 23h 59 (heure d’été).
(2)- Sans déconner, quand on est con on est con… Déconner, en 1655, était un verbe rattaché aux pratiques amoureuses et qui portait encore l’empreinte du sens originel du con… Déconner c’était -suite à une faute de carres- partir en hors-piste. Aujourd’hui le verbe a glissé dans un sens différent.
(3)- À partir de cette époque le nombre de cons n’a fait que croitre. L’historien italien Carlo M. Cipolla dans les Lois fondamentales de la stupidité humaine, estime aujourd’hui que leur nombre est supérieur à ce qu’on pense. C’est naturellement beaucoup mais reste imprécis. Il prévient : « le con est partout peut-être même dans votre lit quand vous dormez la nuit ». Ce qui n’a rien de rassurant.
On estime aujourd’hui qu’il y a au minimum un con dans chaque réunion, trois par famille et sept dans les longues listes d’attente. Mais il n’y a pas de chiffres officiels précis et indiscutables comme on en rencontre par exemple dans le chiffrage des manifestants selon les syndicats et selon la police.
(4)- En réalité être con n’est pas si difficile à porter car le con est, le plus souvent, anosognosique. Ce terme médical désigne un malade qui n’est pas conscient de sa maladie. C’est le plus souvent une lésion vasculaire (un AVC) dans le cortex pariétal postérieur droit qui conduit à ce trouble déficitaire de la perception de soi. De la même façon que le mort n’est pas conscient d’être mort. Probablement…
(5)- Gustave Flaubert avait une aversion déclarée pour la bêtise. Il a longtemps souhaité écrire « une encyclopédie de la bêtise humaine ». La tâche était immense. Il voulut la simplifier en montrant dans un roman (Bouvard et Pécuchet) « son jugement sur l’homme et sur les œuvres de l’homme ». C’était une sorte de testament mais il mourut le 8 mai 1880 sans l’avoir terminé. En commençant son récit Flaubert avait écrit à Tourgueniev : « Il me semble que je vais m’embarquer pour un très long voyage, vers des régions inconnues, et que je n’en reviendrai pas. Un mois avant sa mort il écrit cette autre lumineuse prémonition : « Bouvard et Pécuchet m’embêtent et il est temps que ça finisse ; sinon je finirai moi-même ».
Profitez de la rubrique complète en cliquant ICI.