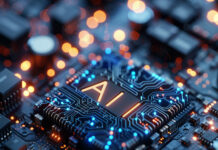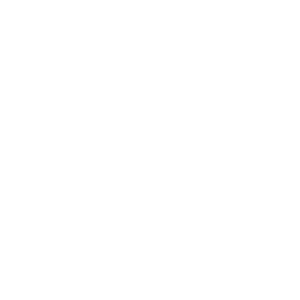C’était un lundi déraisonnable.
L’angélus de sept heures venait de sonner, je quittai mon cher village, tandis qu’un timide soleil de printemps se levait au loin. En rejoignant Dole, je regardais défiler les villages, les quartiers : les maisons et leurs cheminées fumantes. Le tableau était idyllique.
J’envisageais quel pouvait être le contenu de ces foyers, ces autres vies voisines et pourtant si étrangères, j’imaginais des personnages, j’inventais des histoires, je construisais des intrigues. Comme ça, juste pour le plaisir. Depuis toujours, cette évasion projective me fascinait. Le fil d’Ariane était tendu, il n’y avait plus qu’à le suivre.
Ce lundi semblait étrangement déraisonnable car l’obligation du pass vaccinal et du port du masque venait d’être suspendue dans les commerces, les salles de classe ou sur les lieux de travail.
Ainsi, sans obstacle, sans contrainte, sans voile sur nos émotions, nous nous sentions presque nus. C’était assez troublant, pour ne pas dire désagréable, d’être ainsi librement exposés (voire exhibés) au regard de chacun.
Bon nombre d’enseignants découvraient le visage de leurs élèves. Certains en étaient décontenancés.
On mesurait alors toute l’étendue du chemin de croix qu’il nous avait fallu entreprendre, malgré nous.
Prenait-on enfin conscience jusqu’à quel point, les clés de notre destin nous avaient été dérobées ?
Les exaltations d’un soir, les rencontres imprévues, les restaurants improvisés, l’ivresse des sensations… L’essentiel nous avait été confisqué, inutilement, et pour de mauvaises raisons.
Une fois le centre-ville dolois rejoint, je constatais que les gens semblaient anormalement heureux. Quelques-uns portaient encore le masque, mais la majorité de mes congénères apparaissaient libérés.
Tout ce petit monde avait-il déjà oublié qu’il y a près de deux ans, il nous fallait remplir une attestation pour aller acheter du pain ? Qu’il nous était formellement interdit de sortir plus d’une heure et à plus d’un kilomètre de notre domicile ?
S’étaient-elles déjà évaporées, toutes les fâcheuses conséquences traumatiques de ces injustifiées et injustifiables assignations à résidence ?
“Arrête de ressasser toujours la même chose ! Il faut passer à autre chose, retrouver notre vie d’avant, et vivre avec” me rétorquait-on, d’un ton presque moqueur, au café du matin.
De peur de ne parvenir à me contenir, je préférai ne pas répondre.
Moins abîmée que moi par ces deux ans passés sous cloche, surtout probablement victime de moindres turpitudes existentielles préalables, l’assemblée (pourtant composée d’âmes éclairées) n’aurait pas pu assimiler que pour parvenir à “passer à autre chose” et “vivre avec”, il eut fallu que le passif soit intégralement soldé. Que l’instrumentalisation des peurs à des fins purement politiques soit assumée. Que sans obtenir d’explications, d’excuses et de réparation, demeuraient toujours à mon esprit de latentes et insidieuses angoisses, des sensations de perte d’adhérence, comme les ombres des menaces de dénonciation en cas d’un footing trop prolongé ou trop éloigné…
Or pour eux, en ce lundi 14 mars, tout cela, était déjà bien loin. C’était d’ailleurs à se demander si tout cela avait existé.
Ce lundi-là était déraisonnable. Le maître des horloges avait réussi son coup.
L’illusion était parfaite, le public complaisant. J’enviais tous ces insouciants qui se réjouissaient.
Consciemment ou inconsciemment, ils avaient déjà pardonné.
Ils avaient lâché prise. Ils avaient renoncé. Ils avaient abandonné.
Ce dont j’étais bien incapable…